|







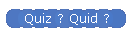




|
|
De 1900 à 1920 l'énergie électrique connut son premier essor.
Pendant cette période le développement de l'électricité est limité
aux villes et chefs-lieux de cantons, aux agglomérations les plus
peuplées ou de caractère industriel; rares sont les communes rurales
électrifiées. Parmi celles-ci citons par exemple dans les Alpes :
Chaumont, Savigny, Valleiry, alimentées vers 1910 par la Société
d'Electricité du Rhône et du Fornant et vers 1913 le Secteur des
Avenières, grâce à la générosité d'une richissime américaine, Mme
Dina.
De même que dans les Alpes, un certain nombre d'intallations
importantes avaient été réalisées avant 1914 dans les Pyrénées dont
l'équipement total était de 65.000 kVA au moment de la première
guerre mondiale. La Compagnie du Midi, qui commençait
l'électrification d'une partie de son réseau, avait entrepris la
construction des usines de Soulom et d'Eget.
En ce qui concerne la distribution, les grandes compagnies
existantes (Société Méridionale de Transport de Force et
Société Pyrénéenne d'Energie Electrique) étendaient progressivement leurs
réseaux. Elles avaient comme concurrents de petits concessionnaires
locaux qui, pouvant utiliser sur place l'énergie électrique, étaient à la fois producteurs et distributeurs. Ils se
servaient de la force d'une basse chute.
On n'électrifiait encore que des villes ou des bourgs d'importance
moyenne, aucune législation ne réglementant l'électrification rurale
ni le transport de l'énergie. De petites sociétés locales naissaient
cependant : tel le réseau du général Dedieu - Anglade, un des
premiers distributeurs ruraux de la Haute-Garonne, et même de
France; ou encore « La Luchonnaise », la société de l'Arize. Ces
réseaux étaient alimentés par de petites usines d'une puissance de
50 à 200 kVA. Des industriels, minotiers, papetiers, fabricants de
produits chimiques, construisaient des usines pour leur compte et
distribuaient sur place leurs excédents de courant. Cette période
d'avant 1914 ne faisait pas encore prévoir le développement rapide
qui devait suivre.
On ne trouve aucun souci d'unité, chaque petite ville a son
concessionnaire; celui-ci, suivant ses conceptions ou ses besoins,
construit et distribue comme il l'entend. On a une véritable
mosaïque de concessions, de tensions et de tarifs. Les frais
d'établissement des usines, lignes et postes de transformation, sont
entièrement pris en charge par le concessionnaire, les capitaux
investis sont en général rentables; ils le deviennent d'ailleurs
largement par la suite grâce à l'activité industrielle et. à la dévaluation de la monnaie. Il semble naturel que la
distribution, pour ses premières armes, ait ainsi pratiqué une
politique « d'écrémage ». L'inconnu que représentait, tant au point
de vue technique que financier, le programme de l'électrification
rurale, explique cette prudence.
La période de guerre de 1914 à 1918 correspond à un moment de fièvre
en raison du stimulant créé par les nécessités de la défense
nationale. Il en résultera un développement rapide des usines
hydrauliques dans les Alpes et dans les Pyrénées. Des fabrications
de produits azotés s'installèrent. Pour leur fournir l'énergie on
construisit dans les Alpes les usines de Fond-de-France (1918),
Tencin (1916), La Boume (1919), et dans les Pyrénées celles de
Bordères, Loudenvielle, Saint - Lary, Beyrède - Jumet, la
centrale du Lac d'Oô, etc...
Après l'armistice de 1918, on constate dans l'aménagement des forces
hydrauliques un léger arrêt dû à l'obligation pour les industries de
guerre de réorganiser leurs fabrications et de les aiguiller vers
des buts plus pacifiques. L'absence de liaison électrique entre les
divers centres freine également ce développement. La loi du 16
octobre 1919, qui réglemente la production et le transport de
l'énergie hydroélectrique, est un des éléments de la reprise de
l'activité des travaux d'aménagement.
En 1921, la Compagnie du Midi, qui avait déjà procédé à
l'électrification de quelques lignes de montagne, continue sur une
échelle beaucoup plus grande et entreprend un programme complet. En
même temps que l'achèvement et la mise en service de ses usines,
elle poursuivit la construction d'un réseau à 60.000 volts et
l'équipement de postes à très haute tension, interconnectés entre
eux par de grandes lignes à 150.000 volts, capables de transformer
et de transporter des puissances bien plus élevées que celles
nécessaires à la traction. En effet, le Comité pour
l'Electrification des chemins de fer, créé en 1920, considérant que
la traction électrique n'absorbait que 10 à 151% environ de la
consommation totale du pays en énergie était arrivé à la conclusion
qu'il serait préférable d'établir un réseau de transmission
d'énergie qui serait commun aux chemins de fer et aux entreprises
de distribution au lieu de construire un réseau spécial pour la
traction.
En conséquence, dès 1923, se constituait, fondée par M. Maroger, une
Union des Producteurs d'Energie des Pyrénées Occidentales
(U.P.E.P.O.). Le but de cet organisme était, en utilisant le réseau
de transport d'un de ses membres, de faciliter à tous les
producteurs le placement de leur énergie. C'est la réalisation de
cette fédération, facilitée par les lignes de transport des Chemins
de Fer du Midi, qui a donné à l'électrification de la région
pyrénéenne une impulsion décisive.
De 1921 à 1935 beaucoup d'usines étaient terminées en France; dans
les Alpes : Viclaire, La Perrière-Vignotan, Pizançon, Rondeau, Le
Chambon et St-Guilherme, le Sautet, Bissorte, les usines du Doron-de-Beaufort;
dans les Pyrénées : Artouste, Miègebat et le Hourat sur le gave
d'Ossau, les usines de la vallée d'Aspe, de la vallée de
l'Aude, les
centrales de Tramesaygues et de Lassoula; dans le Massif Central :
Eguzon, le Pinet, Val Beneyte , Coindre,. Marèges, Brommat et
Sarrans.
Au point de vue de la distribution de nouvelles sociétés
apparaissent pour s'emparer des concessions, « des groupes »
viennent concurrencer les sociétés locales. On assiste à de
véritables guerres entre ces sociétés et ces groupes qui se
disputent chacun une partie du territoire.
La finance internationale s'en mêle et tente d'accaparer la
production et la distribution pour les englober dans un vaste trust
groupant toutes les entreprises françaises. Cette action, un moment
partiellement victorieuse, échoue ensuite de justesse en raison des
contre-attaques françaises et de l'arrivée de la crise mondiale,
source d'énormes perturbations boursières.
L'alerte étrangère passée, la lutte continue entre les sociétés
françaises pour le partage du pays. Il n'est question dans les
rapports des ingénieurs et des financiers qui dirigeaient ces
entreprises que « de champ de bataille industriel » de « terrain
d'opérations ». Il fallait « enlever une concession » comme
autrefois on enlevait une bastille. Il est évident que, comme dans
toute guerre, il y avait des adversaires loyaux et d'autres moins
scrupuleux, agissant sans merci.
La législation de la distribution elle-même avait évolué, facilitant
l'électrification totale de régions entières par l'attribution de
subventions aux communes (loi du 2 août 1923). Jusque là le
distributeur avait financé à peu près seul les travaux
d'électrification ; il avait choisi de ce fait les endroits les plus
rémunérateurs et délaissé l'électrification rurale.
A partir de 1923 le distributeur ne fit plus les frais des nouveaux
réseaux qui incombèrent à la collectivité. Les charges dépassant le
rendement à attendre des capitaux engagés, nul ne se serait plus
soucié d'électrifier des régions pauvres. D'autre part, de nouvelles
utilisations commencent à se répandre, la demande des consommateurs
augmente, la clientèle devient plus difficile. Les concessionnaires
des petits réseaux éprouvent des difficultés croissantes par suite du manque d'énergie et la
plupart d'entre eux voient une élévation de
leurs charges, sans contre-partie de recettes suffisantes. Les
petits distributeurs cherchent à céder leurs concessions à des
sociétés, les sociétés elles-mêmes tombent dans le giron de
consortiums plus puissants, on s'achemine vers l'unité.
Arrêt de la poursuite de l'équipement.
Pour en revenir à la production, à partir de 1933, l'équipement des
usines a dépassé les capacités d'absorption de la clientèle;
plusieurs régions se trouvaient encore isolées par suite de
l'absence de lignes d'interconnexion à grande distance suffisamment
étoffées. Ces raisons, jointes à la crise économique, arrêtèrent la
construction des usines hydro-électriques.
Cette période de stagnation de six ans, dont nous sortions à peine
en 1939, fut singulièrement funeste puisque nous en subissons
aujourd'hui le contre-coup. On retarda systématiquement durant ce
laps de temps l'achèvement de presque tous les projets en cours ; on
n'entreprit rien de nouveau alors que les moyens ne manquaient pas
et que des constructions très coûteuses s'élevaient un peu partout.
Nous avons eu des stades, des piscines, des bibliothèques, des
gares, des hôtels des postes, des palais de justice mais nous avons
manqué d'usines et de barrages.
Et la guerre revint. La fièvre reprit les constructeurs d'usines.
Trop tard. L'équipement des chutes ne s'improvise pas. 1940,
expiation cruelle des erreurs antérieures. Tout vint à manquer. Plus
d'essence, plus de charbon. Seule l'énergie hydro-électrique restait
mais il ne fallait pas, c'est le cas de le dire, en perdre la
moindre goutte.
La nationalisation.
Le plan qui avait été établi en 1938 pour compléter l'équipement
électrique de la France fut complètement dépassé. La deuxième guerre
mondiale achevée, il fallut d'abord réparer les ruines heureusement
limitées subies par les ouvrages de production et de transport puis
partir sur un pied nouveau. Le Conseil National de la Résistance
avait dans son programme d'Alger décidé de nationaliser la
production, le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Cette nationalisation intervint, après de longs débats à l'Assemblée
Constituante, le 8 avril 1946.
La nationalisation de l'électricité en France n'a été ni une
surprise ni un événement isolé. Elle marquait l'issue d'un état de
fait qu'il importe d'évoquer. Dans tous les pays qui sont entrés
dans le stade capitaliste de la production économique, le mouvement
naturel de la concentration des capitaux imposé par la concurrence
avait abouti depuis longtemps à la monopolisation des branches
essentielles de l'économie et à l'interpénétration des capitaux
consacrés originellement à des activités différentes. De puissant es
féodalités financières se constituèrent ainsi, qui non seulement
imposaient leur volontéà l'évolution de l'économie mais étaient
aussi tout naturellement portées à s'immiscer de plus en plus
efficacement dans les affaires publiques et dans la politique de
l'Etat.
La France, en 1938, se situait à un niveau de consommation d'énergie
très inférieur à celui de nombreux pays, malgré ses grandes
possibilités. Chaque américain ou suisse consommait trois fois plus
d'électricité qu'un français, chaque canadien ou norvégien cinq fois
plus. En outre, cette consommation ne pouvait être satisfaite que
grâce à des importations de combustibles considérables. La France
était en effet tributaire de l'étranger pour 20 à 25 millions de
tonnes de charbon chaque année. Comme le constatait l'exposé des
motifs du projet gouvernemental : « A la veille de la guerre,
l'alimentation du pays en électricité, du fait de l'insignifiance
notoire de notre équipement hydro-électrique, était dans une
certaine
mesure à la merci d'un arrêt des importations ».
Une oeuvre importante avait été accomplie dans le domaine de
l'industrie électrique mais cette oeuvre demeurait très inégale. Les
meilleurs efforts avaient abouti à la création d'un remarquable
réseau d'interconnexion (la France était le seul pays, avant la
guerre, à posséder un réseau national fonctionnant sous une tension
de 220.000 volts). En revanche l'effort dans l'équipement productif
était demeuré insuffisant.
La loi finalement adoptée a tenu compte de toutes les contingences.
D'une part, elle a nationalisé l'industrie électrique dans son
ensemble — production, transport et distribution, —d'autre part elle
a laissé subsister une certaine décentralisation ou du moins a rendu
possible une éventuelle dispersion. En effet, elle a séparé le «
Service National d'Electricité de France » du « Service
National du Gaz de France » et elle a prévu au sein de chacun de ces services la
création de secteurs dotés d'une autonomie relative qui restent à
fixer par une loi ultérieure. En outre, elle a laissé en dehors de
la nationalisation les entreprises dont la production annuelle
demeure au-dessous de certains maxima.
En même temps que le législateur établissait le nouveau régime de la
production, du transport et de la distribution de l'énergie
électrique, les techniciens se souciaient de renforcer le potentiel
énergétique du pays et étudiaient les possibilités d'un équipement
rapide de nos ressources. Cela fit l'objet du plan Monnet qui
prévoit pour l'électricité une production doublée en 1951 par
rapport à 1939, soit environ 40 milliards de kWh au lieu de 20.
Les chantiers en sommeil se sont rouverts, on a mis en construction
un grand nombre de nouvelles chutes. On rénove les centrales
thermiques. On complète le réseau d'interconnexion. Au cours des
pages qui vont suivre, nous nous rendrons compte de l'importance de
ce renouveau.
Sources :
Energie Electrique en France L. Babonneau Mai 1949 Privat
Toulouse
Histoire du Service de la Production Hydraulique
1946-1992 AHEF Décembre 1995
|
